 |
 |
 |
 |
 |
| |
 |
|
Droit international: force contraignante et valeur interprétative du préambule
|
 |
- La force obligatoire du préambule est une question d’espèce. Si certains auteurs affirment que la force obligatoire du préambule est inexistante[6], d’aucuns émettent une opinion plus nuancée en se fondant notamment sur la nature supplétive des dispositions du préambule qui pourraient permettre de combler les lacunes du traité[7]. Toutefois, les auteurs semblent reconnaître qu’en aucun cas le préambule d’un instrument ne saurait valoir à l’encontre d’une disposition qui lui serait incompatible[8].
- Lors de l’élaboration des normes de l’OIT, la question de la force obligatoire du préambule a été fréquemment posée. Le Conseiller juridique a constamment rappelé que le préambule était non contraignant et que sa principale fonction était de prévoir le contexte dans lequel l’instrument s’insérait.
- La valeur interprétative du préambule d’une convention internationale est pour sa part incontestable. L’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités dispose «(qu’) aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend» notamment «le texte, préambule et annexes (…)». En d’autres termes, la détermination du sens à attribuer à une disposition particulière repose sur l’examen de l’ensemble du texte du traité, y compris le préambule[9]. Dans la pratique de l’OIT, toutefois, le préambule a rarement été utilisé aux fins d’interprétation de la portée d’une disposition d’une convention internationale du travail tant dans les opinions délivrées par le Bureau à la demande des Membres que par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans son examen de l’application d’une convention particulière. Ainsi, le fait que le préambule d’une recommandation précise qu’elle complète une convention a permis de considérer qu’il ne semble guère possible qu’elle puisse comporter des dispositions qui ne seraient pas compatibles avec celles de la convention elle-même[10]. Dans un autre cas, la portée de la définition des «gens de mer» a été précisée en se référant notamment au préambule de la convention et aux instruments antérieurs de l’OIT auxquels il se réfère[11].
|
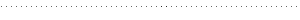 |
[6] N. Quoc Dinh, P. Daillier, A. Pellet: Droit international public (septième édition), L.G.D.J., Paris, 2002, p. 131.
[7] Voir M.K. Yasseen: L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités, Académie de droit international (extrait du recueil des cours, vol. III-1976), A.W. Sijthoff, Leyden, 1976, p. 35. Par exemple, dans l'Affaire des ressortissants des Etats-Unis au Maroc, la Cour internationale de Justice (CIJ) a noté que la garantie de l'égalité de traitement avait été insérée dans le préambule de l'Acte d'Algésiras du 7 avril 1906 et a conclu que, «[v]u à la lumière des circonstances précitées, le principe apparaît clairement comme ayant été destiné à avoir le caractère d'une obligation, et non à rester seulement une formule vide» (CIJ, Rec. 1952, p. 184). En outre, il faut aussi noter qu'un préambule ou des clauses spécifiques de ce dernier peuvent, sous l'effet du processus coutumier de formation normative, acquérir une valeur contraignante. A cet égard, la Clause de Maertens, incluse notamment dans le préambule de la 4e Convention de La Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre in fine, est un exemple probant. Voir également C. Rousseau: Droit international public, tome I: Introduction et sources, éditions Sirey, Paris, 1970, p. 87.
[8] Voir Yasseen, op. cit., p. 35.
[9] Ibid., p. 34. Voir également La compétence de l’Organisation internationale du Travail dans les questions de travail agricole, CPJI, avis consultatif n° 2, reproduit dans le Bulletin officiel, vol. VI, 1922, n° 10, tel que publié dans CPJI, série B, n° 2 & 3, pp. 36-41. Voir aussi «Rapport de la Commission de la protection de la maternité», Compte rendu provisoire n° 20, CIT, 88e session, 2000, paragr. 68, où le Conseiller juridique du BIT estime que le préambule des conventions peut être utilisé à des fins interprétatives comme élément du contexte.
[10] Opinion du Bureau concernant la convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, Autriche, Bulletin officiel, vol. XLV, 1962, n° 3, p. 259, paragr. 10.
[11] Opinion du Bureau concernant la convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, Pologne, Bulletin officiel, vol. LVII, 1974, n° 2-4, p. 219-220, paragr. 6. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
|