 |
 |
 |
 |
 |
| |
 |
|
Différentes questions relatives à la rédaction |
 |
| Général |
- L’examen du recours à l’expression «et/ou» oblige à préciser la portée des conjonctions de coordination «et» et «ou» utilisées séparément.
- La conjonction «et» utilisée seule ne soulève pas vraiment de difficulté d’interprétation et vise à lier les parties d’une proposition et à exprimer une addition. Dans un texte juridique qui fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu’un droit ou une obligation puisse être tenu comme respecté, l’usage de la conjonction «et» signifie que ces conditions sont cumulatives et qu’elles doivent dès lors toutes être honorées.
- L’usage de la conjonction de coordination «ou» est un peu plus ambigu. Inclusive en principe, le «ou» peut prendre, exceptionnellement, une valeur exclusive[398] selon le contexte où il est employé. Ainsi, la conjonction «ou» peut signifier, selon le contexte, une indifférence quant au fait que les parties de la proposition se réalisent toutes ou non («ou» inclusif). Toutefois, le «ou» peut aussi véhiculer l’idée qu’une seule des propositions doit se réaliser («ou» exclusif ou alternatif). Il s’agit notamment des cas où la conjonction «ou» sert à lier deux propositions mutuellement exclusives, qui ne peuvent coexister sans créer une contradiction de sens ou une impossibilité pratique.
- Le recours à l’expression «et/ou» dans certains textes techniques, dont les textes à caractère juridique, vise à éviter que la conjonction «ou» soit prise dans son sens exclusif ou alternatif. Or il n’est pas certain que le recours à cette formule permette de résoudre les ambiguïtés de langage. L’Honorable Louis-Philippe Pigeon, ancien Juge à la Cour suprême du Canada écrivait, alors qu’il était professeur titulaire de droit constitutionnel, à l’égard de «et/ou»:
-
Que dire maintenant de «et/ou»? «Et/ou» est tout simplement inadmissible. Je vous citerai une partie de ce que dit à ce sujet Daviault dans son ouvrage «Langage et traduction» au mot «and/or». Il relate ces paroles d’un juge des Etats-Unis qui caractérise de la façon suivante «and/or»: «A befuddling nameless thing, that Janus-faced verbal monstruosity neither word nor phrase, the child of a brain of someone too lazy or too dull to know what he means.» (Une chose confuse et sans nom, une monstruosité verbale à «double face», ni mot ni phrase, l’invention d’une personne trop paresseuse ou bête pour savoir ce qu’elle veut dire: traduction du Bureau.)
-
«Et/ou» semble avoir été employé par des gens qui se préoccupent avant tout de paraître savants. Je crois que c’est tout à fait l’opposé. L’utilisation de cette conjonction, qui n’en est pas une, est une chose qui répugne au génie de la langue, aussi bien en anglais qu’en français. Il faut prendre le temps de réfléchir et construire la phrase de façon à ne pas recourir à cet artifice[399].
|
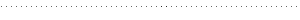 |
[398] C’est-à-dire que «l’addition des deux possibilités est exclue».
[399] Louis-Philippe Pigeon: Rédaction et interprétation des lois, deuxième édition, Québec, éditeur officiel du Québec, 1978, p. 35. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
|